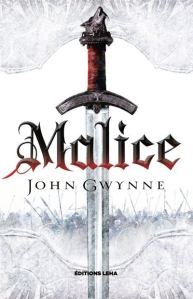Vertigineux
 Venise, début du XVIIe. Thene est mariée à un homme violent, qui la rabaisse et dilapide leur argent dans le jeu. Et ce d’autant plus volontiers qu’une Maison des jeux est récemment apparue sans que nul ne puisse se souvenir de sa construction. On y trouve deux divisions : l’inférieure est celle des activités banales d’un tel établissement, tandis que la supérieure n’est accessible que sur invitation. La Maîtresse des lieux propose à Thene une épreuve lui permettant de l’intégrer, une partie où on ne mise pas d’argent mais un peu de soi (un talent, l’acuité d’un sens aiguisé, des années de vie, etc.), où on ne joue pas avec de banals accessoires mais avec des gens. Chaque Joueur dispose d’une somme d’argent pour les pots-de-vin, d’un Roi, de Cartes / Pièces (des individus aux talents ou relations utiles, inféodés à la Maison en échange de l’effacement d’une dette), et Thene a en plus une pièce d’or dont elle n’apprendra l’origine et la puissance réelle qu’au cours de la partie. À part l’interdiction de blesser un autre Joueur et l’obligation, pour gagner, de faire couronner son Roi, tous les coups sont permis. Ici, l’enjeu est que ce dernier devienne Tribun au Sénat, un poste qui a plus de pouvoir réel que le Doge. Pour Thene, l’enjeu réel est d’être reconnue comme une personne puissante, libre, et non plus comme la femme battue et méprisée d’un bon à rien.
Venise, début du XVIIe. Thene est mariée à un homme violent, qui la rabaisse et dilapide leur argent dans le jeu. Et ce d’autant plus volontiers qu’une Maison des jeux est récemment apparue sans que nul ne puisse se souvenir de sa construction. On y trouve deux divisions : l’inférieure est celle des activités banales d’un tel établissement, tandis que la supérieure n’est accessible que sur invitation. La Maîtresse des lieux propose à Thene une épreuve lui permettant de l’intégrer, une partie où on ne mise pas d’argent mais un peu de soi (un talent, l’acuité d’un sens aiguisé, des années de vie, etc.), où on ne joue pas avec de banals accessoires mais avec des gens. Chaque Joueur dispose d’une somme d’argent pour les pots-de-vin, d’un Roi, de Cartes / Pièces (des individus aux talents ou relations utiles, inféodés à la Maison en échange de l’effacement d’une dette), et Thene a en plus une pièce d’or dont elle n’apprendra l’origine et la puissance réelle qu’au cours de la partie. À part l’interdiction de blesser un autre Joueur et l’obligation, pour gagner, de faire couronner son Roi, tous les coups sont permis. Ici, l’enjeu est que ce dernier devienne Tribun au Sénat, un poste qui a plus de pouvoir réel que le Doge. Pour Thene, l’enjeu réel est d’être reconnue comme une personne puissante, libre, et non plus comme la femme battue et méprisée d’un bon à rien.
Ce roman, le premier d’une trilogie, chose rarissime dans la collection Une heure-lumière, normalement formée de textes indépendants, est très facile à résumer d’un unique mot : vertigineux. L’idée de base, celle d’une organisation qui jouerait avec les hommes comme des pièces sur un plateau de jeu, n’est pas inédite (on pensera évidemment à L’Échiquier du mal de Dan Simmons), mais est excellemment exploitée. Car Thene découvrira que les activités de la Maison s’étendent loin dans le Temps (au moins jusqu’à la Rome antique) et dans l’Espace, impliquant nations et religions, servant de timonier au navire Historique, esquissant une Histoire Secrète comme on en a rarement vu. Vertigineuse est l’érudition de l’autrice, qui nous immerge dans une Venise plus vraie que nature, à la fois splendide et hideuse lorsqu’il s’agit de montrer à quel point la vie humaine y a peu de valeur, à quel point on y est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Vertigineuse est la portée philosophique de ce texte, d’une opposition entre Ordre et Chaos que ne renieraient ni Moorcock, ni Zelazny, à ceci près qu’ici la balance est bancale, car un des camps triche. Vertigineuse est la maîtrise de Claire North en matière de personnages (Thene en premier lieu) et d’intrigue (dans tous les sens du terme). Et surtout, vertigineuse est la qualité de sa plume, une prose qui ne se lit pas mais envoûte. Qualificatif souvent galvaudé… mais pas ici. Et ce d’autant plus que la fin, qui montre que les pièces restent, pourtant, des êtres humains, est magistrale.
Le Serpent est une vertigineuse ouverture de cycle, qui, via les allusions qu’elle fait à quelque chose d’infiniment plus complexe que le cadre spatio-temporel restreint qui nous est montré dans cette Venise du XVIIe, ne peut qu’aiguiser l’appétit du lecteur pour les tomes suivants. On a ici indubitablement affaire à un des meilleurs Une heure-lumière publiés depuis la fondation de la collection !
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez avoir un deuxième avis sur ce court roman, je vous recommande la lecture des critiques suivantes : celle de Lutin, celle de Célinedanaë, du Maki, de Hugues sur Charybde 27, de Feydrautha, de Gromovar, de Just a word, du Nocher des livres, d’Ombrebones, de Xapur, de Zoé prend la plume (sur l’ensemble de la trilogie), de Boudicca, de Dionysos, de Lianne, de Yuyine,
***





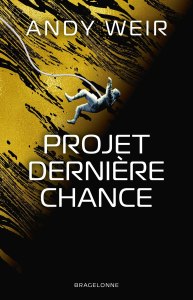
 Le monde rouge décrit dans Le grand livre de Mars n’est pas celui que nos robots et nos satellites nous ont dévoilé, mais celui, conforme aux maigres connaissances en planétologie de la première moitié du XXe siècle, imaginé dans le sillage d’astronomes comme Giovanni Schiaparelli ou Percival Lowell, une Mars dotée d’une atmosphère respirable et d’une vie indigène tentant de lutter contre la désertification en creusant de vastes réseaux de canaux. La planète rouge de l’âge d’or de la SF n’est pas tant fantasmée en sœur plus sèche de la Terre, dotée de civilisations indigènes quasi-humaines, qu’en accord avec ce que la science de la première moitié du siècle dernier faisait entrer dans le champ du possible. Une illusion qui viendra se fracasser sur le mur du réel quand, en 1964, la sonde Mariner 4 transmettra les premières images et données scientifiques de Mars : non seulement il n’y a ni canaux, ni civilisation, mais la planète n’a pas d’atmosphère respirable et est stérile. Le programme Mariner n’aura pas seulement un grand impact scientifique, il repoussera la spéculation science-fictive liée aux extraterrestres au-delà du Système solaire. Celui de Brackett étant devenu irréaliste aux yeux des lecteurs, elle devra se résoudre à transposer les aventures de son héros fétiche, Eric John Stark, sur une planète extrasolaire.
Le monde rouge décrit dans Le grand livre de Mars n’est pas celui que nos robots et nos satellites nous ont dévoilé, mais celui, conforme aux maigres connaissances en planétologie de la première moitié du XXe siècle, imaginé dans le sillage d’astronomes comme Giovanni Schiaparelli ou Percival Lowell, une Mars dotée d’une atmosphère respirable et d’une vie indigène tentant de lutter contre la désertification en creusant de vastes réseaux de canaux. La planète rouge de l’âge d’or de la SF n’est pas tant fantasmée en sœur plus sèche de la Terre, dotée de civilisations indigènes quasi-humaines, qu’en accord avec ce que la science de la première moitié du siècle dernier faisait entrer dans le champ du possible. Une illusion qui viendra se fracasser sur le mur du réel quand, en 1964, la sonde Mariner 4 transmettra les premières images et données scientifiques de Mars : non seulement il n’y a ni canaux, ni civilisation, mais la planète n’a pas d’atmosphère respirable et est stérile. Le programme Mariner n’aura pas seulement un grand impact scientifique, il repoussera la spéculation science-fictive liée aux extraterrestres au-delà du Système solaire. Celui de Brackett étant devenu irréaliste aux yeux des lecteurs, elle devra se résoudre à transposer les aventures de son héros fétiche, Eric John Stark, sur une planète extrasolaire.