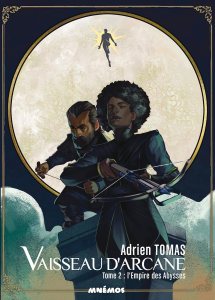Un très bon roman, une édition grand format d’une qualité exceptionnelle
 En 1985, Denis Gerfaud publie le Jeu de rôle Rêve de dragon, dans lequel le monde est issu du songe des mythiques reptiles. En 2022, ce rôliste chevronné qu’est David Bry crée Oestant, une île qui, à quelques touches nordiques près, doit tout à la (Grande-) Bretagne du Haut Moyen Âge, et est issue des rêves de trois géants. Vu que certaines analogies sont transparentes (on retrouve un roi Arthus, un Lancelin, un Caradec, un Bohort, etc.), que le personnage de Morfessa évoque très fortement Merlin (prophéties, capacité à faire franchir à des armées des centaines de kilomètres en un temps surnaturellement court, comme l’a fait l’Enchanteur avec celle se rendant à Bedegraine), et qu’il y a plus que de vagues analogies avec l’histoire de Tristan et Iseut (particulièrement la version écrite en 1226 par le Frère Robert, comprenant elle-même des éléments de mythologie scandinave en plus de celle des Celtes), il serait tentant de ne voir dans Le Chant des Géants qu’un roman inspiré par la Matière de Bretagne. Ce serait toutefois négliger le fait que l’Iliade est une grille de lecture au moins aussi valable (Sile équivalant alors à Hélène, Bran à Pâris et Ianto à Ménélas), d’autant plus que le récit a la dimension d’une épopée, à la puissante dramaturgie digne d’une tragédie grecque, jusqu’à l’utilisation habile, sur la fin, de la péripétie, ou « twist » comme on le dit aujourd’hui.
En 1985, Denis Gerfaud publie le Jeu de rôle Rêve de dragon, dans lequel le monde est issu du songe des mythiques reptiles. En 2022, ce rôliste chevronné qu’est David Bry crée Oestant, une île qui, à quelques touches nordiques près, doit tout à la (Grande-) Bretagne du Haut Moyen Âge, et est issue des rêves de trois géants. Vu que certaines analogies sont transparentes (on retrouve un roi Arthus, un Lancelin, un Caradec, un Bohort, etc.), que le personnage de Morfessa évoque très fortement Merlin (prophéties, capacité à faire franchir à des armées des centaines de kilomètres en un temps surnaturellement court, comme l’a fait l’Enchanteur avec celle se rendant à Bedegraine), et qu’il y a plus que de vagues analogies avec l’histoire de Tristan et Iseut (particulièrement la version écrite en 1226 par le Frère Robert, comprenant elle-même des éléments de mythologie scandinave en plus de celle des Celtes), il serait tentant de ne voir dans Le Chant des Géants qu’un roman inspiré par la Matière de Bretagne. Ce serait toutefois négliger le fait que l’Iliade est une grille de lecture au moins aussi valable (Sile équivalant alors à Hélène, Bran à Pâris et Ianto à Ménélas), d’autant plus que le récit a la dimension d’une épopée, à la puissante dramaturgie digne d’une tragédie grecque, jusqu’à l’utilisation habile, sur la fin, de la péripétie, ou « twist » comme on le dit aujourd’hui.
À ces inspirations ou ces convergences issues de la littérature classique, il faut en ajouter d’autres venant de la Fantasy moderne : le récit est fait par un mystérieux conteur dans une auberge, ainsi que par un flûtiste sur une colline, et leurs interventions forment le fil rouge du roman, le rapprochant du Nom du vent de Patrick Rothfuss ; l’atmosphère est certes dramatique et épique, mais elle a aussi une puissante dimension mélancolique, voire onirique, rappelant l’Ursula Le Guin de Terremer, référence revendiquée par Bry, tout comme Marion Zimmer Bradley, dont le cycle d’ Avalon a peut-être inspiré ses très beaux personnages féminins ; l’économie de mots de Le Guin, et sa capacité à créer, malgré tout, une puissante atmosphère, se retrouvent aussi chez David Gemmell, et l’écriture ciselée de Bry, où le gras est quasiment absent des os, tout comme la dimension guerrière et l’empathie ressentie pour des protagonistes très humains, semble venir tout droit de chez le britannique (le côté nerveux en moins).
Avec de telles inspirations et le talent de Bry, on est bien proche du chef-d’œuvre, même si quelques éléments peuvent tempérer l’enthousiasme : cette histoire de deux princes se disputant une femme et le pouvoir, l’un par amour et sens de l’Honneur, l’autre rongé par un complexe d’infériorité et des passions (comme on disait dans le Jeu de rôle Pendragon) dévorantes, est tout de même bien (trop) classique ; l’immersion dans les sentiments de Bran en fait certes un personnage attachant et de ce roman une lecture vivante, prenante, mais son histoire d’amour (proche de celle de Tristan, donc ne relevant pas du fin’amor) est parfois horripilante quand il s’interdit d’y céder, et un poil guimauve quand il finit par le faire, sans compter sa foi mal placée en son frère ; l’auteur adopte pour certaines scènes un staccato de phrases courtes avec retour à la ligne à la James Ellroy (écrivain avec lequel il a aussi en commun la thématique de la rédemption) en rupture avec le reste du style du livre, qui oblige à une gymnastique mentale d’autant plus agaçante que la description des combats est assez répétitive ; certains lecteurs seront frustrés par la place modeste (bien que capitale) prise par les Géants ; la fin, si elle est très réussie, tranche tout de même avec la couleur émotionnelle générale du texte ; enfin, Bry ne se renouvelle guère, ce nouvel opus étant tout de même bien proche de certains des précédents.
Mais en fin de compte, Le Chant des Géants est indubitablement un très bon roman, surtout pour qui aime ses sources d’inspiration, et d’autant plus recommandable que le contenu est sublimé par une édition grand format d’une qualité exceptionnelle pour son prix assez modeste (signalons aussi que la version poche est sortie il y a quelques semaines).
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez avoir un deuxième avis sur ce roman, je vous recommande la lecture des critiques suivantes : celle de Célinedanaë, celle de Boudicca, de Tachan, de Ma Lecturothèque, des Fantasy d’Amanda, de Yuyine, de Zoé prend la plume, de Fourbis et Têtologie, de l’Ours Inculte,
***
Retour à la page d’accueil
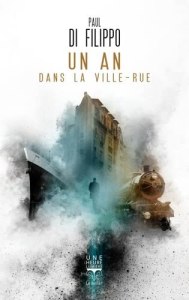 Imaginez une ville composée de millions de pâtés de maisons (Combien exactement ? Nul ne le sait), formant une Avenue limitée d’un côté par les Voies (ferrées), de l’autre par le Fleuve, artères de transport permettant à de mystérieux bienfaiteurs d’acheminer aux différents Arrondissements, qui ne produisent rien, tout ce dont ils ont besoin. Au-delà de ces deux artères vitales, il y a l’Autre Rivage et le Mauvais côté des Voies, séjour des âmes des morts que viennent chercher les Psychopompes planant sans cesse dans les airs, où deux « soleils » éclairent cet étrange monde. Dont les habitants humains savent qu’ils n’en sont pas les bâtisseurs, ne connaissent ni le début ni la fin de ce ruban d’asphalte, peut-être infini, et sont incapables de créer la moindre technologie (niveau début du XXe siècle), seulement de la réparer ou la modifier. Lire la suite
Imaginez une ville composée de millions de pâtés de maisons (Combien exactement ? Nul ne le sait), formant une Avenue limitée d’un côté par les Voies (ferrées), de l’autre par le Fleuve, artères de transport permettant à de mystérieux bienfaiteurs d’acheminer aux différents Arrondissements, qui ne produisent rien, tout ce dont ils ont besoin. Au-delà de ces deux artères vitales, il y a l’Autre Rivage et le Mauvais côté des Voies, séjour des âmes des morts que viennent chercher les Psychopompes planant sans cesse dans les airs, où deux « soleils » éclairent cet étrange monde. Dont les habitants humains savent qu’ils n’en sont pas les bâtisseurs, ne connaissent ni le début ni la fin de ce ruban d’asphalte, peut-être infini, et sont incapables de créer la moindre technologie (niveau début du XXe siècle), seulement de la réparer ou la modifier. Lire la suite